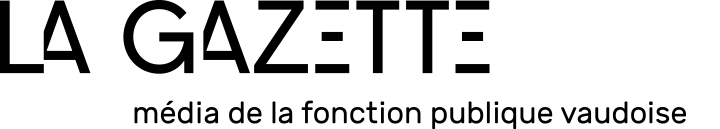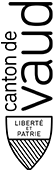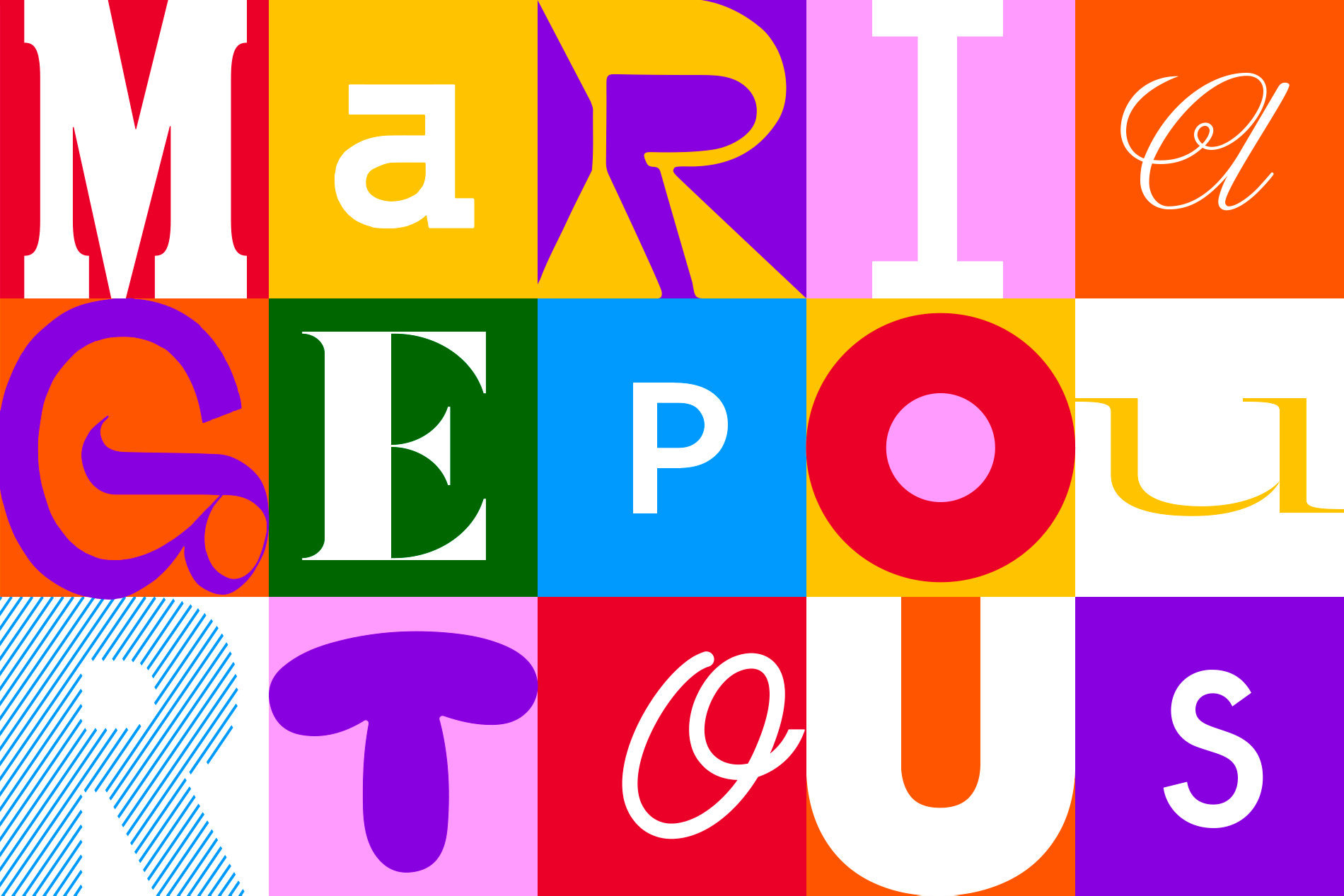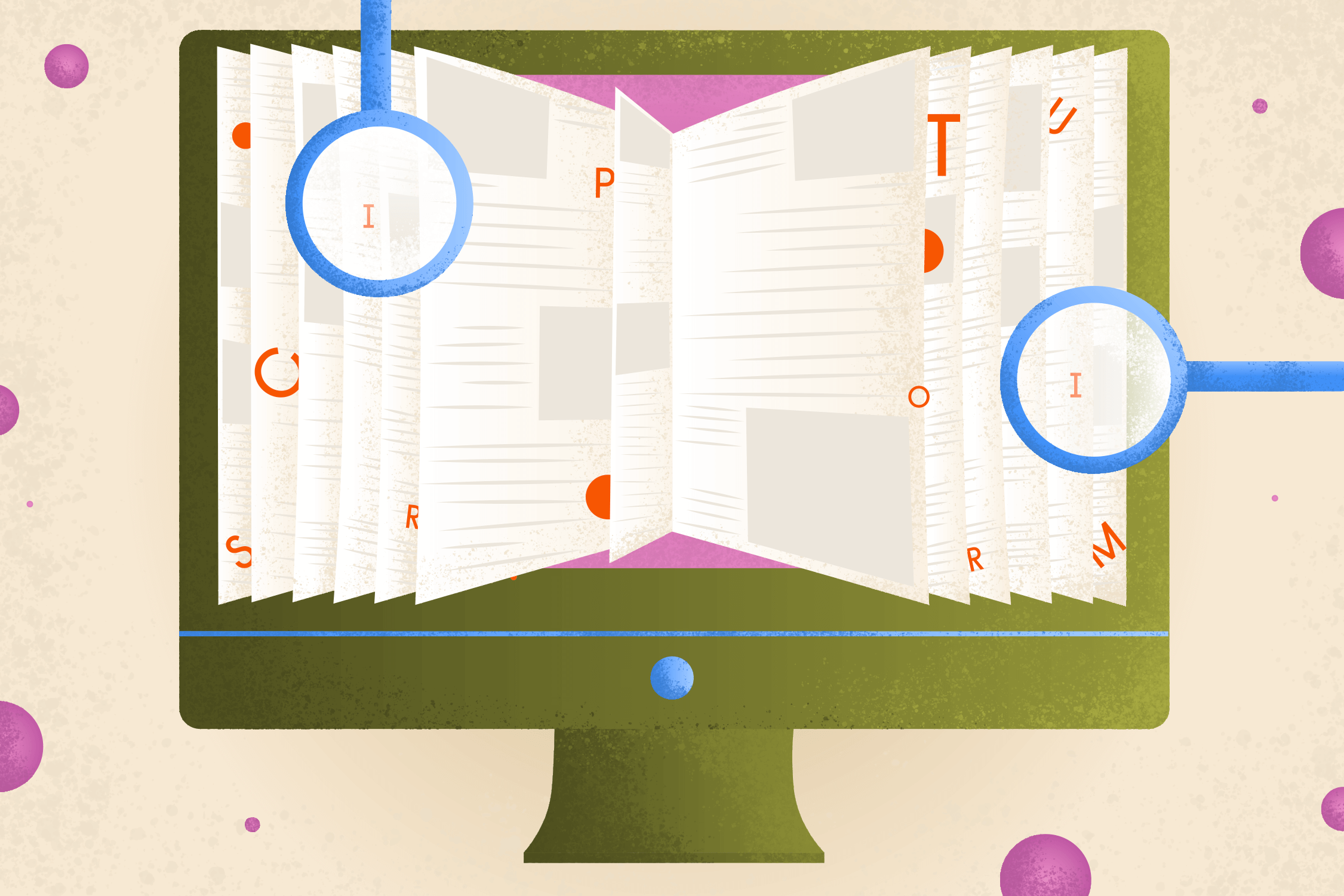La taxidermie dans la peau
Dans son atelier du Musée cantonal de zoologie, André Keiser redonne vie aux animaux morts, des plus petits aux plus gros, du roitelet huppé au tigre de Sibérie.
L’atelier est un univers poétique en soi. Des centaines d’outils de toutes sortes débordent de toutes parts. Chaque recoin est occupé par des objets et des matériaux disparates, dont tous peuvent servir à un moment à un autre pour rendre « vie » à un animal. Car André Keiser est taxidermiste. Sorte de passeur entre le monde des vivants et des morts, son métier remonte quasiment aux temps anciens. Tanneurs, embaumeurs, empailleurs, les humains n’ayant eu de cesse de conserver les corps morts, son appellation a varié au gré des techniques nouvelles.
Sur son établi, un goéland leucophée. André Keiser le manipule avec délicatesse. Avant toute chose, il prend son poids et ses mesures, la longueur de ses ailes, de son bec. André Keiser exerce son métier depuis bientôt 40 ans. Après un apprentissage de taxidermiste, en 1984, au Muséum d’histoire naturelle de Genève et un court passage au Naturhistorisches Museum de Bâle, il devient en 1990 le taxidermiste attitré du Musée cantonal de zoologie de Lausanne.
 Un goéland leucophée, bientôt immortalisé. | Image: FA (BIC)
Un goéland leucophée, bientôt immortalisé. | Image: FA (BIC)Le vaste monde des vertébrés
En quelques mots, André Keiser résume le métier de taxidermiste à la préparation et la conservation des vertébrés uniquement. Même si le mot « uniquement » ne lui plait pas, trop restrictif à ses yeux : « Le monde des vertébrés est un monde si vaste. Il comprend les oiseaux, qui ne pèsent que 4 ou 5 grammes, comme le roitelet huppé ou le troglodyte mignon, jusqu’à l’autruche dont le poids peut varier entre 70 et 140 kilos. »
Puis, il y a l’univers des mammifères qui n’est pas moins varié, puisqu’il va du très petit au très gros, de la chauve-souris bourdon à l’éléphant. André Keiser se souvient d’une visite à un confrère parisien qui apprêtait de gros animaux, mais qui disposait d’une véritable halle avec des palans : « Pour préparer les grosses bêtes, l’outillage n’est pas le même. Autant dire que ce n’est presque plus le même métier. »
Écharnage et bourrage
La naturalisation d’un animal se décortique en plusieurs étapes : tout d’abord, le dépouillage, il s’agit d’écorcher l’animal le plus vite possible après sa mort pour éviter la chute des plumes ou des poils. Les étapes suivantes sont l’écharnage qui consiste à enlever la chair des os et le dégraissage qui permet de racler l’intérieur de la peau pour enlever les derniers résidus encore présents. La peau est enfin tannée permettant de mieux la conserver en la protégeant de la putréfaction de la chair et des insectes.
Commence alors la construction de la charpente : un assemblage de fils de fer ou bois qui donne la structure de l’animal, comme un squelette. Le bourrage permet ensuite de reproduire la forme du corps de l’animal à l’état naturel avec les muscles et graisses, mais à l’aide de paille, foin ou filasse.
Enfin, le positionnement permet de donner à l’animal l’apparence du vivant. Il faut donc tasser la paille mise à l’intérieur de la peau. Pour terminer, les finitions consistent en la mise en place des yeux, la coloration de parties nues, la pose d’un vernis pour donner un aspect humide typique de l’animal vivant.
Un métier en évolution
La façon d’apprêter les animaux de la manière que nous connaissons encore aujourd’hui date plus ou moins du 18e siècle. Comme l’explique André Keiser, au début, les pièces n’étaient pas vraiment conservées. Celles qui étaient exposées dans des cabinets de curiosités étaient vite détruites par des insectes ravageurs. Les objets ont commencé à se conserver avec l’invention de certains agents chimiques comme le savon arsenical, mélange de savon et d’arsenic. Mais depuis l’interdiction de certains pesticides, les choses sont en train de changer à grande vitesse. Désormais, il s’agit d’explorer de nouvelles techniques : « Après de multiples essais, la technique de tannage sans ajout d’agent insecticide s’est affinée et s’impose désormais comme la fin du processus de conservation. »
Le squelette de la bête
De même, la structure intérieure, celle qui remplace le squelette de l’animal, est en constante évolution : « Lorsque j’ai appris le métier, nous employions de larges mélanges de matériaux, comme le bois, le métal, le plâtre, de la laine de bois ou plus anciennement la paille - qui a donné le terme d’empailleur. Maintenant, nous commençons à utiliser des matériaux synthétiques dont l’usage est beaucoup plus simple, comme la mousse de polyuréthane. » Ce matériau présente de gros avantages : « Il est durable, facile à mettre en œuvre et il nous épargne des assemblages de matériaux lourds, qui peuvent se désagréger et mal se comporter les uns avec les autres. »
 La peau d’Oural, tigre de Sibérie récemment décédé au zoo de Servion. | Image: FA (BIC)
La peau d’Oural, tigre de Sibérie récemment décédé au zoo de Servion. | Image: FA (BIC)Le tigre de Sibérie en vedette
Les animaux qui finissent entre les mains d’André Keiser proviennent en grande partie de La Vaux-Lierre, un centre de soins à Etoy qui recueille les oiseaux sauvages blessés : « Pour qu’un animal présente une valeur scientifique, on doit connaître la date et le lieu où on l’a trouvé. Quand il arrive au centre de soin, un merle blessé reçoit une fiche qui indique quand et où il a été recueilli. Cette fiche accompagne l’animal post mortem. »
Les animaux exotiques proviennent de parcs animaliers. Comme le tigre de Sibérie, vedette du zoo de Servion qui est aujourd’hui l’une des pièces maîtresses du Musée de zoologie. « En 1995, la tigresse malade avait dû être euthanasiée. La bête était énorme et devait peser près de 180 kilos. Pour travailler sur un animal de cette taille, j’avais demandé de l’aide à mon père, boucher dans une autre vie, qui savait enlever la peau avec soin. Ce fut une sacrée aventure, et un long travail de modelage et de sculpture pour reconstituer son corps grâce à un assemblage de fer, de ficelle, de laine et de bois ».
 L’une des fiches qui indique la date et le lieu où l’on a trouvé un animal qui sera traité par le taxidermiste. | Image: FA (BIC)
L’une des fiches qui indique la date et le lieu où l’on a trouvé un animal qui sera traité par le taxidermiste. | Image: FA (BIC)Restauration du requin blanc
Parmi les pièces bien connues du public, André Keiser a également participé à la restauration du requin blanc. Pêché au large de Sète en 1957, il avait été offert en donation au Musée cantonal et avait voyagé en wagon frigorifique jusqu’aux abattoirs de Lausanne où il fut en partie préparé. « Quand il a fallu le restaurer il y a quelques années, l’un des collaborateurs du musée, avec un talent certain pour la peinture, s’était chargé de nettoyer et repeindre la bête, un travail minutieux et délicat. Pour ma part, je m’étais occupé des parties en cuir (véritable cuir de poisson). Il s’agissait de les ramollir, les recoller et les refermer. Il a également fallu remplacer une demi-douzaine de dents, qui avaient été volées au fil du temps. »
 Céline, apprentie, vient d’entamer une formation longue de quatre ans, dont les cours théoriques sont dispensés en Autriche. | Image: FA (BIC)
Céline, apprentie, vient d’entamer une formation longue de quatre ans, dont les cours théoriques sont dispensés en Autriche. | Image: FA (BIC)Un métier d’avenir
Aux côtés du taxidermiste, Céline, tout sourire, est concentrée sur l’écharnage d’un petit oiseau. Après un stage de quelques semaines dans l’atelier d’André Keiser, elle s’est également prise de passion pour ce métier. Elle vient d’entamer une formation longue de quatre ans, dont les cours théoriques sont dispensés en Autriche. « La profession n’est plus au bénéfice d’un CFC. Mais le Congrès suisse des taxidermistes mène une bataille pour que le métier soit à nouveau reconnu. Comme la Confédération semble s’intéresser à nouveau aux métiers à faible effectifs, nous avons bon espoir d’obtenir bientôt une reconnaissance fédérale, » conclut André Keiser. (DA)