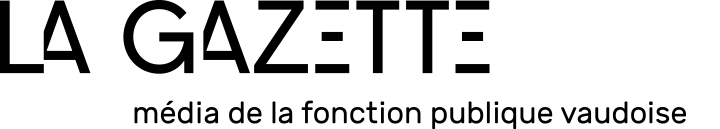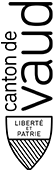Santé des femmes au travail: on prend la température
Menstruations, maternité, ménopause. Quelles réalités souvent compliquées recouvrent ces «3 M» qui jalonnent la vie d’une femme et que l’on ne soupçonne pas toujours? À quoi faut-il veiller lors d’une situation oncologique? On fait le point en compagnie de deux spécialistes en gynécologie et du responsable de la réinsertion professionnelle à la Direction générale des ressources humaines (DGRH) du Canton de Vaud.
En Suisse, l’endométriose, une maladie inflammatoire pouvant être invalidante, touche entre 10 et 15% des femmes en âge de procréer. Quant à la ménopause, dont l’âge moyen est estimé à 52 ans, elle concerne environ un million de femmes dans notre pays et se traduirait chez un tiers d’entre elles par des symptômes ou troubles transitoires pouvant affecter le quotidien professionnel. Gynécologue aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et responsable de l’Unité d’oncogynécologie chirurgicale, la doctoresse Manuela Undurraga se réjouit pourtant: «Nous vivons une période intéressante pour les femmes, avec une vraie prise de conscience d’une santé qui leur est propre, et plus d’une santé masculine appliquée aux femmes: nous avons résolument des processus métaboliques différents!»
Maux féminins: l’indispensable prise de conscience
Dans la sphère professionnelle, certaines questions de santé propres aux femmes ont fait leur chemin (lire plus bas). Comme le rappelle Julien Ravussin, responsable de la réinsertion professionnelle à la DGRH, les questions d’égalité entre femmes et hommes sont très importantes pour le Conseil d’État, l’Etat employeur et tous les services de l’administration cantonale. «À la Direction Qualité de vie au travail, nous souhaitons vraiment prendre à bras le corps ces problématiques : des projets d’accompagnement et de sensibilisation autour des questions de ménopause et d’endométriose (et d’andropause) sont en cours de réflexion. Pour les femmes bien sûr, mais aussi pour leurs collègues masculins qui ne se rendent pas toujours bien compte de ce qu’elles vivent au quotidien.» L’objectif principal? « Sensibiliser un maximum de monde à ces sujets, et inciter les femmes à en parler avec leur manager ou leur référent RH : l’enjeu principal est de lever les tabous et de ne pas ajouter de stress et de culpabilité à des problèmes bien humains».
L’endométriose, une maladie gynécologique encore mal connue
Gynécologue aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), la doctoresse Antonella Martino est responsable du Centre d’endométriose, un des rares centres de Suisse certifié par la Ligue européenne et la Fondation scientifique d’endométriose. Elle y reçoit des femmes dès l’adolescence, même si elle observe un pic de la maladie entre 25 et 35 ans. Première idée reçue contre laquelle elle se bat: les règles sont douloureuses et c’est comme ça. «Certains symptômes se sont normalisés, mais non, ce n’est pas toujours normal d’avoir mal pendant ses règles!»
«Non, ce n’est pas toujours normal d’avoir mal pendant ses règles!»
Concrètement, cette maladie se caractérise par le développement de tissu semblable à la muqueuse utérine, en dehors de l’utérus, qui entraîne une inflammation et une fibrose. «C’est une maladie multifactorielle aux manifestations variées qui n’ont pas toutes le même degré de sévérité. Elle est encore sous-diagnostiquée et mal connue, déplore Antonella Martino. C’est une maladie chronique, comme le diabète par exemple, et l’on peut apprendre à vivre avec en gardant une bonne qualité de vie.»
Malgré cela, il n’est pas rare que des crampes menstruelles douloureuses empêchent certaines femmes de travailler dans de bonnes conditions, surtout lorsqu’elles sont dans un bureau. Difficile de venir avec une bouillotte au travail ou de se plier en deux sur son siège… Sans compter que l’endométriose est souvent associée à d’autres maux comme les migraines, le syndrome du côlon irritable ou la fibromyalgie. «La douleur peut alors devenir chronique: dans ce contexte, la tolérance à la douleur diminue en raison d’une sensibilisation excessive du système nerveux», explique Antonella Martino. Un des symptômes souvent ignorés qui en découle? Une fatigue chronique que viendrait alimenter le stress, connu pour son action inflammatoire. De quoi voir son environnement de travail perturbé.
 Souvent, des crampes menstruelles douloureuses empêchent certaines femmes de travailler dans de bonnes conditions, surtout lorsqu’elles sont dans un bureau. Illustration | mozZz-Firefly
Souvent, des crampes menstruelles douloureuses empêchent certaines femmes de travailler dans de bonnes conditions, surtout lorsqu’elles sont dans un bureau. Illustration | mozZz-FireflyLa ménopause, un phénomène hormonal souvent banalisé
La doctoresse Manuela Undurraga reçoit quant à elle beaucoup de patientes en ménopause, un phénomène naturel que l’on diagnostique après un an complet d’aménorrhée, aux alentours de la cinquantaine, et qui peut présenter des manifestations invalidantes sur plusieurs années. Elle évoque aussi la périménopause – une période charnière avant la ménopause qui se traduit par des cycles irréguliers et des symptômes désagréables – qui touche, selon elle, des «patientes de plus en plus jeunes, dès 35-40 ans».
Parmi les symptômes vasomoteurs les plus courants de la ménopause, on note les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, «des symptômes qui ont longtemps été banalisés, voire confondus avec des pathologies psychiatriques et qui sont encore loin d’être pris en charge de manière adéquate…», déplore Manuela Undurraga. «La ménopause est aussi une source d’insomnie, ce qui génère de la fatigue et des difficultés de concentration. Des symptômes variés et parfois invalidants qui peuvent parfois expliquer les absences professionnelles de courte durée chez les femmes.
Que fait l’État pour ses collaboratrices?
Au sein de l’Administration cantonale vaudoise, la sensibilisation aux questions de santé des femmes est désormais intégrée dans les parcours de formation des cadres et des RH. L’occasion de rappeler également qu’à l’État, le dispositif normatif permet de gérer une absence ponctuelle sans justificatif formel, et ainsi soutenir les collaboratrices lors de difficultés liées à des règles douloureuses ou à des symptômes hormonaux transitoires.
Comme le rappelle Julien Ravussin, «si la récurrence des absences est trop importante, un entretien de clarification entre le manager et la personne permet alors de réfléchir à un meilleur soutien.» Suivant la fonction occupée, on peut par exemple réfléchir à une annualisation du temps de travail, avec des horaires plus libres – afin de compenser une dette de sommeil ponctuelle ou de calmer des douleurs hormonales, ou encore à du télétravail – à même d’offrir plus de confort physique dans certains cas. Aujourd’hui, l’endométriose est reconnue comme invalidante pour certaines femmes par l’AI: «Notre rôle RH est aussi d’aider ces personnes dans leurs démarches auprès de la Caisse de pensions de l’État de Vaud, qui peut même reconnaître une situation invalidante à taux très partiel», détaille Julien Ravussin.
«Dans le cas des cancers, le temps de récupération est important. Les effets de la fatigue se font encore sentir un an après.»
Cancers et maladies longue durée : hommes et femmes, même combat
Dans le cas des absences longue durée auxquelles il est confronté, Julien Ravussin évoque bien sûr les cancers. «Nous avons une procédure adaptée pour tout ce qui concerne l’accompagnement de nos collaboratrices et collaborateurs dans ces maladies et l’aide à la reprise du travail, surtout dans le cas d’une limitation fonctionnelle. Après un cancer du sein, il faut par exemple veiller à limiter le portage, à ne pas accomplir de tâches qui impliquent de lever les bras… Nous essayons de nous adapter à la reprise de chacune (et chacun), que cela passe par une modification temporaire du cahier des charges, un aménagement du poste de travail (comme le télétravail qui permet de limiter l’exposition aux virus pour les personnes immunodéprimées) ou du volume horaire.» Car dans le cas des cancers, comme le rappelle Manuela Undurraga, le temps de récupération est important: «Les effets de la fatigue se font encore sentir un an après. On parle notamment de chemobrain, ce brouillard cérébral après l’administration d’une chimiothérapie, qui peut entraîner des troubles de la mémoire ou de l’attention. Sans compter le choc psychologique du contrecoup…» Encore une fois, des troubles cognitifs, physiques et psychiques qui peuvent entraîner des répercussions sur le bien-être au travail et dont il faut avoir conscience. (EB)
La directive Maternité
Difficile de parler de la santé des femmes sans évoquer la grossesse. Dans le monde du travail, certaines questions y relatives ont déjà fait leur chemin. En témoigne la directive Maternité de l’État de Vaud, entrée en vigueur en 2022, et qui règlemente également l’allaitement au travail. Voir la Gazette de mai 2022.