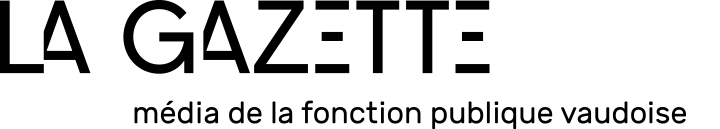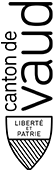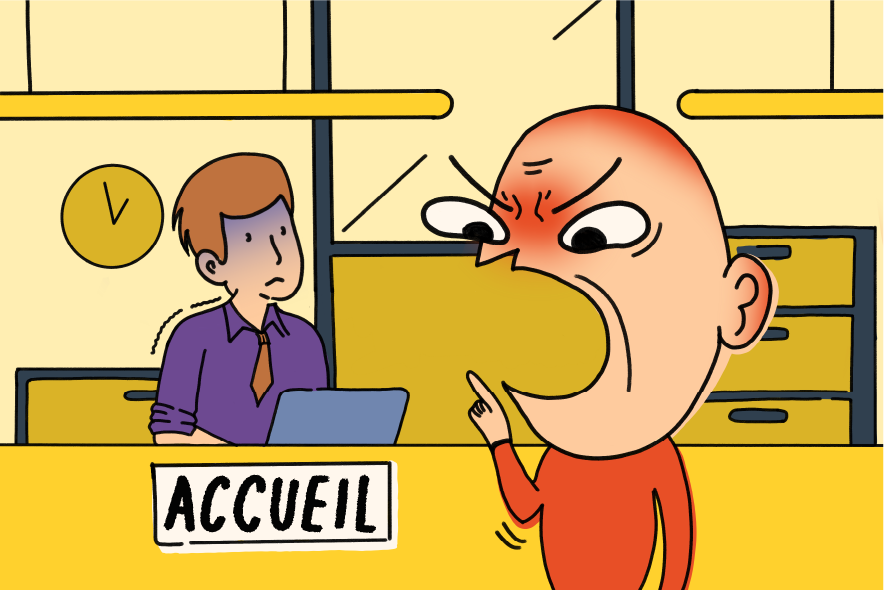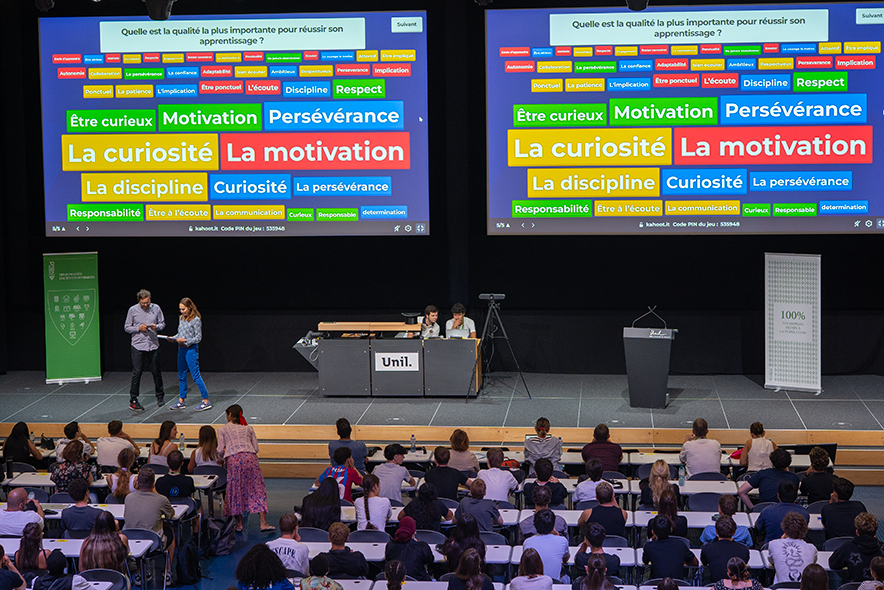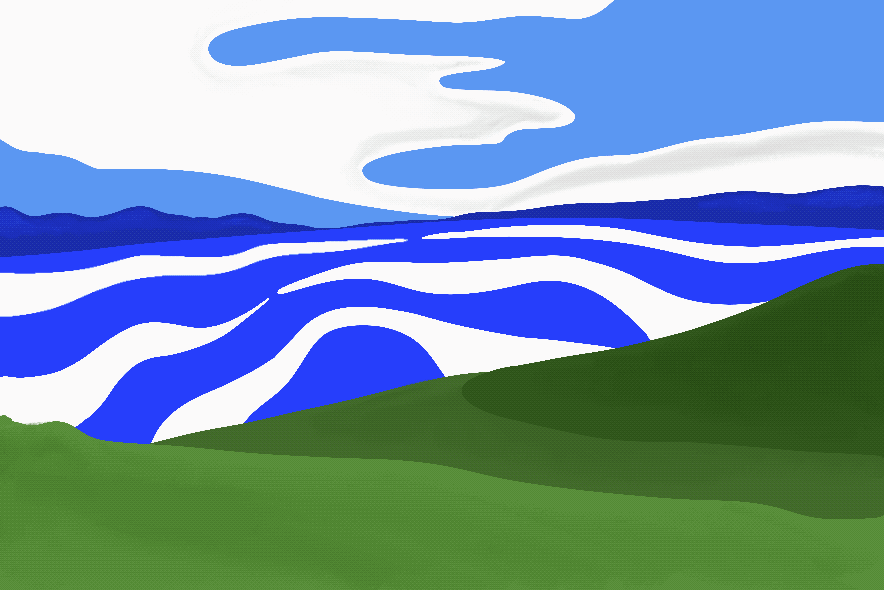Quel est l’impact de la violence au CHUV ?
La violence dans les services publics n’est plus un phénomène marginal. Dans les hôpitaux comme ailleurs, elle s’exprime sous des formes multiples, parfois banalisées par ceux qui la subissent. Pierre Merminod, adjoint au chef de la sécurité du CHUV, décrit une réalité complexe et les moyens mis en place pour y faire face.
«Parler de violence dans un hôpital n’est plus anecdotique, c’est une réalité. L’hôpital est un reflet de la société: ce qui se passe à l’extérieur se retrouve aussi à l’intérieur. Comme les pompiers et ambulanciers qui, parfois, se font agresser, le personnel hospitalier subit aussi des comportements violents.»
En quelques chiffres, Pierre Merminod pose le diagnostic: «Le Service de sécurité du CHUV fait appel à la police environ 50 fois par an, soit presque une fois par semaine. Entre 2023 et 2024, le nombre d’interventions de nos agents de sécurité pour des situations complexes a bondi de 40%.» Il convient cependant de mettre ces chiffres en perspective avec les 54'000 patients accueillis au CHUV pour une hospitalisation et les 92'000 personnes reçues aux urgences en 2024.
Ces agressions verbales ou physiques sont-elles surtout commises la nuit ou le week-end? «Ce critère n’est plus valable. Il n’y a plus d’heure. Désormais, aucun jour, aucun moment n’est épargné. Selon nos statistiques, nous observons néanmoins une légère baisse en fin de matinée…» Tous les services du CHUV sont concernés: « L’augmentation est constante. Les plus exposés sont les urgences somatiques et psychiatriques, ainsi que les services qui accueillent des patients avec des troubles cognitifs.»
 Pierre Merminod, de la sécurité du CHUV : «Nous appelons la police presque une fois par semaine.» Photo | ARC-Sieber
Pierre Merminod, de la sécurité du CHUV : «Nous appelons la police presque une fois par semaine.» Photo | ARC-SieberDes agressions physiques… et des mots qui blessent
Comme le souligne Pierre Merminod, la violence ne se limite pas aux coups. Souvent, ce sont même les paroles qui marquent le plus. «Des phrases comme Vous êtes une incapable ou Si j’attends, c’est parce que vous êtes nul peuvent être terriblement blessantes pour le personnel. Sans parler d’accusation de racisme: C’est parce que je suis de telle ou telle origine que vous me faites attendre. Pour nos équipes dévouées, qui ont pour seul critère l’urgence médicale, ce type de reproche est inadmissible.»
Pour Pierre Merminod, il faut cependant distinguer les agressions physiques commises par quelqu’un souffrant d’une pathologie et incapable de discernement («agressions qui ne sont pas en augmentation») d’un individu incapable de maîtriser sa frustration ou son émotion, ou encore d’une personne sous l’emprise de l’alcool ou de drogues: «La réponse sera évidemment différente.» Mais toutes les situations ne sont pas signalées. «Peut-être pour se protéger mentalement, certains préfèrent minimiser : Il m’a juste insulté, il m’a juste craché dessus… alors qu’il s’agit de comportements intolérables. Résultat, nos chiffres ne traduisent qu’une partie de la réalité.»
Recadrer, prévenir, protéger
Pour améliorer la sécurité de son personnel, le CHUV a mis en place un dispositif de signalement qui permet d’annoncer directement toute situation conflictuelle. Elle sera alors prise en charge par une équipe pluridisciplinaire. En cas de situation d’urgence, le personnel peut également déclencher une alarme qui permet de mobiliser en nombre les agents de sécurité ou la police.
Comme le souligne Pierre Merminod, chaque cas déclaré est examiné. «Nous analysons chaque situation pour éviter la récidive.» Et les conséquences vont crescendo, selon la gravité des faits. Au CHUV, une personne qui a commis des actes de violence qui ont été signalés reçoit une lettre recommandée au nom de la direction générale. Le courrier rappelle les faits et leurs conséquences et avertit qu’en cas de récidive, des mesures seront prises. En deuxième lieu, la direction du CHUV peut agir par le biais d’une convocation policière afin de recadrer une personne qui a commis des actes de violence, sans suite judiciaire. Enfin, le dépôt d’une plainte pénale par la victime est possible.
Des agents formés à la désescalade
En parallèle, une commission institutionnelle – réunissant, notamment, la direction médicale, soins, urgences, psychiatrie, juristes, communicants – suit trimestriellement l’évolution des indicateurs pour permettre à tous d’avoir un même niveau d’information, et, sur cette base, d’analyser le phénomène dans toute sa complexité; et ensuite de décider des mesures à prendre ou de leur adaptation. L’existence de cette commission pluridisciplinaire est d’autant plus précieuse que le problème tient aussi à la spécificité d’un hôpital: «Tout le monde est libre d’entrer dans un hôpital. Contrairement à une boîte de nuit, une personne connue pour des comportements violents ne peut être rejetée si elle a besoin de soins. Mais elle sera encadrée par un dispositif de sécurité coordonné avec les médecins», précise Pierre Merminod.
Dans cet environnement, la présence d’agents de sécurité est devenue essentielle. «Mais il faut savoir que l’essentiel de leur travail repose sur la désescalade verbale. Leur présence en uniforme change souvent la donne en faisant baisser la tension, ce qui constitue déjà une forme de prévention. Notre objectif n’est pas de contraindre, mais d’apaiser.»
 Les services les plus exposés sont les urgences somatiques et psychiatriques, et ceux qui accueillent des patients avec des troubles cognitifs. Photo | RFBSIP
Les services les plus exposés sont les urgences somatiques et psychiatriques, et ceux qui accueillent des patients avec des troubles cognitifs. Photo | RFBSIPRéduire les facteurs de tension
La prévention passe également par la formation. Les soignants, ainsi que le personnel administratif, sont formés à gérer ce type de situation, surtout celles et ceux qui sont en première ligne, par exemple, à l’accueil.
D’autres mesures visent également à réduire les tensions: «Nous déployons des campagnes de sensibilisation et travaillons sur des améliorations toutes simples, mais qui peuvent avoir un effet apaisant pour limiter le sentiment d’impatience qui peut déclencher des situations tendues. Par exemple, un meilleur confort dans les salles d’attente, du Wi-Fi, ou encore l’installation de distributeurs à boissons et nourriture».
En guise de conclusion, Pierre Merminod souligne combien la sécurité des patients et du personnel soignant est une préoccupation permanente. «Nous ne tolérons aucune violence. Chaque situation doit être prise au sérieux et traitée. Rien ne doit être banalisé.»
 L’espace de médiation du CHUV: aujourd'hui sont les soignants qui, de plus en plus nombreux, s'y rendent pour demander un appui ou de l’aide. Photo | Gilles Weber
L’espace de médiation du CHUV: aujourd'hui sont les soignants qui, de plus en plus nombreux, s'y rendent pour demander un appui ou de l’aide. Photo | Gilles WeberHôpitaux sous tension : des soignants en souffrance
Face à une montée des violences verbales et physiques à l’hôpital, le personnel soignant du CHUV trouve un appui dans un lieu discret, mais essentiel : l’espace de médiation. Conçu à l’origine pour les patients, il accueille de plus en plus de professionnels en souffrance.
Il y a plus de dix ans, l’espace de médiation du CHUV ouvrait ses portes pour entendre la parole des patients et de leurs proches, souvent perdus dans la complexité d’un hôpital universitaire. Mais aujourd’hui, le centre s’est transformé: ce sont les soignants eux-mêmes qui, de plus en plus nombreux, franchissent le seuil pour demander un appui ou de l’aide.
Directrice du Centre sur le vécu des patientes et patient·e·s, des proches et des professionnel·le·s du CHUV, Béatrice Schaad est à l’origine de sa création: «Les professionnels de la santé ont longtemps cru que savoir résister à la tension ou à une situation de crise traduisait leur professionnalisme. Or, cette posture, encore trop souvent érigée en norme tacite, empêche souvent de reconnaître la souffrance provoquée par des actes de violence ou des conflits avec des patients. Se plaindre d’un patient reste un tabou. Les soignants ont peur d’être jugés, perçus comme fragiles ou incompétents», constate Béatrice Schaad.
Depuis sa création en 2012, l’espace de médiation a recueilli les témoignages de plus de 6200 personnes, soit une moyenne qui varie entre 500 et 600 cas par an. Si les premières années, seuls 3% des usagers étaient des professionnels, ce chiffre a grimpé à 17 % au lendemain de la pandémie.
Renouer le lien avec un patient
Selon Béatrice Schaad, le personnel soignant sollicite l’espace de médiation pour obtenir des conseils sur la gestion de conflits, pour être accompagné dans leur résolution, ou pour être encadré de façon concrète (et dans un cadre sécurisé) afin de renouer un lien avec un patient. À travers ces consultations, il apparaît clairement que les violences à l’encontre du personnel se sont intensifiées. «Ces violences ne relèvent pas uniquement de cas extrêmes. Elles s’inscrivent même souvent dans des relations de soin de longue durée, parfois tendues, souvent éprouvantes. Avec les progrès de la médecine, les patients vivent plus longtemps avec des pathologies chroniques. Les soignants les revoient régulièrement. Et un conflit non réglé ne disparaît pas, au contraire, il s’envenime.»
 Béatrice Schaad, directrice du Centre sur le Vécu des patientes et patient·e·s, des proches et des professionnel·le·s du CHUV: «Avec l’augmentation des primes d’assurance-maladie, certains patients adoptent une posture de client.» Photo | Gilles Weber
Béatrice Schaad, directrice du Centre sur le Vécu des patientes et patient·e·s, des proches et des professionnel·le·s du CHUV: «Avec l’augmentation des primes d’assurance-maladie, certains patients adoptent une posture de client.» Photo | Gilles WeberPosture de client
Béatrice Schaad constate que le poids des attentes s’est également alourdi: «En dépensant une part croissante de leur budget dans les primes maladie, certains patients adoptent, souvent même inconsciemment, une posture de client.» Et face à cette pression, le personnel médical se retrouve bien souvent seul. «Les professionnels ne nous sollicitent généralement que lorsque le conflit a largement dépassé le stade du malaise», regrette Mme Schaad. Un réflexe largement partagé qui s’explique par des études qui montrent que dans ce genre de situations, le personnel craint d’être jugé, voire stigmatisé et d’être perçu comme des professionnels manquant d’endurance et de capacités relationnelles. «Raisons pour lesquels certains minimisent un conflit et veulent le gérer seuls. Ce qui en soi est tout à fait normal. Toutefois cela l’est moins lorsqu’on commence à souffrir de ce conflit sur un plan psychologique.»
Trois grandes zones de friction
Mais les mentalités évoluent. De plus en plus souvent, des membres du personnel soignant demandent un accompagnement pour gérer le conflit ou, tout simplement, pour être entendus. Mais l’objectif de l’espace de médiation n’est pas de désigner un coupable: «On ne cherche pas à savoir si ce que les gens racontent est vrai. Il suffit qu’ils l’aient vécu ainsi pour qu’on s’en préoccupe. Cette approche nous a permis de faire émerger des causes systémiques de tensions en révélant trois grandes zones de friction: l’organisation des soins, les actes cliniques, et surtout la relation humaine.»
Témoigner pour les autres
En analysant les motivations de celles et ceux qui ont recours au centre de médiation, Béatrice Schaad observe qu’ils cherchent avant tout une forme de reconnaissance indirecte: «Ils viennent témoigner avant tout pour que cela n’arrive pas à quelqu’un d’autre. Moi, je vous raconte ce qui s’est passé, je ne veux pas de réparation, je ne veux pas porter plainte, mais j’aimerais seulement que d’autres n’aient pas à le vivre. Un état d’esprit que l’on retrouve aussi bien chez des patients que chez des soignants.»
Aujourd’hui, le CHUV dispose de quatre médiateurs à temps partiel, tous formés à la gestion de conflits, en lien étroit avec la sécurité et les affaires juridiques. «On ne s’improvise pas médiateur. Ce n’est pas qu’une question de bon relationnel, il faut maîtriser des techniques spécifiques.»
Après un pic post-Covid, les plaintes de professionnels semblent aujourd’hui en légère baisse. Un signe d’apaisement? «Peut-être. Mais il faut rester prudent. La souffrance ne se dit pas toujours.» (DA)